Par John Molyneux, in Revue Que Faire ?
L’argument antisocialiste
"Le socialisme est une bonne idée, mais ça ne marchera jamais. On ne peut pas changer la nature humaine". C’est là l’objection la plus courante - et la plus influente - au projet
socialiste. C’est le premier argument qu’on entend à l’atelier, à la cantine ou au café. C’est aussi celui sur lequel s’appuient de nombreux politiciens et intellectuels.
De plus, c’est un argument accepté par beaucoup de gens qui aimeraient bien changer le monde mais qui ne croient pas que ce soit possible. Il est même admis par de gens qui se disent
socialistes, comme de nombreux membres et électeurs du PS ou du PC. Le résultat, c’est qu’ils réduisent l’idée socialiste à un vague aménagement du système plutôt que d’essayer de le changer
complètement.
L’argument de la nature humaine est très utile aux adversaires déclarés du socialisme. Il est bref, précis et convaincant - une réponse courte qui semble clore le débat. Il se relie à
d’autres idées largement admises, comme par exemple : "Il y aura toujours des gens au sommet", "Les humains sont fondamentalement égoïstes", "Il y en a toujours qui
en veulent plus que les autres", "Les révolutions finissent toujours par des tyrannies", etc.
Cette opinion se nourrit de la vieille idée chrétienne que nous sommes tous nés souillés par le péché originel, transmis de génération en génération depuis Adam et Eve et le paradis
terrestre. L’idée qu’il y aurait dans la nature humaine une espèce de tare de base, empêchant toute véritable égalité et toute coopération entre les êtres, semble fournir une explication
toute faite à tous les maux de l’univers - comme par exemple le racisme ou le sexisme. Des problèmes politiques particuliers, comme la dégénérescence de la Révolution Russe en dictature
stalinienne, ou l’échec apparent du socialisme en Europe de l’Est et en Chine, sont aussi mis au compte de la nature humaine.
Ces idées s’appuient sur le vécu personnel de chacun. Qui n’a pas vu des individus se livrer à une compétition acharnée pour la réussite, ou été trahi par un ami cher, ou dégoûté par
l’apathie et l’égoïsme de ses semblables ? Ces expériences ont contribué à faire de l’argument de la nature humaine une simple évidence de "bon sens". Cela dit, nous allons voir qu’il
est complètement faux.
La nature humaine est changeante
Pourquoi dit-on que la nature humaine empêchera toujours le socialisme de devenir réalité ? On prétend qu’il existe un ensemble de caractéristiques, de schémas de comportement et
d’attitudes fondamentales communs à tous - ou presque - les êtres humains, qui sont incompatibles avec la mise en place d’une société sans classe, basée sur la propriété commune et le
contrôle de tous.
En particulier, on affirme que la plupart des gens sont de façon innée avides et ambitieux, qu’ils veulent plus que leur juste part des biens matériels et n’aspirent qu’à dominer leurs
semblables.
Mais tout examen sérieux du comportement humain, même dans notre société, prouve que tout cela n’est pas vrai. Bien sûr, il y a quantité d’exemples de cupidité et de volonté de puissance -
regardez les hommes politiques véreux de droite et de gauche – Chirac, Strauss-Kahn, Tibéri ou Roland Dumas, ou bien le genre de politicien qui gagne régulièrement aux élections
présidentielles américaines. En fait, on trouve beaucoup plus d’exemples de sacrifice, de courage et de solidarité.
Des humains risquent leur vie pour en sauver d’autres de la catastrophe. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison pour la cause en laquelle il croyait, des étudiants et des travailleurs ont
fait face aux tanks sur la place Tiananmen à Pékin en 1989. Les exemples quotidiens abondent : des parents qui se sacrifient pour leurs enfants handicapés, des travailleurs sociaux qui
choisissent des emplois très mal rémunérés plutôt que de chercher à gagner de hauts salaires dans un bureau ou une entreprise commerciale, ou encore la grande générosité de ceux qui répondent
aux appels à la charité publique.
Lorsque sont abordés des problèmes comme la protection sociale, les sans-abri, la retraite ou l’exclusion, l’opinion publique est essentiellement généreuse et sensible. Sous le gouvernement
Juppé, alors que la pensée unique néolibérale semblait toute-puissante, une large majorité a soutenu les travailleurs du secteur public en grève pour défendre la sécurité sociale.
Lorsque des gouvernements s’engagent dans des guerres brutales et sanguinaires, ils savent qu’ils ne pourront avoir le soutien de l’opinion qu’en invoquant des prétextes
"humanitaires". Les Français et les Anglais ont justifié leur entrée dans la Première Guerre mondiale par la nécessité de voler au secours de la pauvre petite Belgique agressée par
le "militarisme prussien". De même, l’Otan a justifié son intervention dans les Balkans par la défense des Albanais du Kosovo menacés de "nettoyage ethnique" par les
ignobles Serbes.
Il ne s’agit pas de démontrer que les hommes sont naturellement altruistes. Mais il est idiot de prétendre qu’ils sont, de façon innée et irrémédiable, cupides et égocentriques. Certains
sacrifieront tout pour leur famille mais ne lèveront pas le petit doigt pour leur voisin en difficulté. D’autres répondront généreusement aux appels à la charité mais laisseront leurs enfants
dans le besoin. Il y a des personnes qui sont capables d’une immense sympathie pour les animaux mais n’ont que mépris pour leurs semblables, et vice-versa.
Cela dépend des circonstances, selon que les gens se sentent vulnérables et menacés, ou bien forts et sûrs d’eux-mêmes. Ou si le problème qui leur est posé se relie aux attitudes dans
lesquelles ils ont été élevés, ou qu’ils ont adoptées au cours de leur vie. En bref, les humains changent en même temps que leurs conditions d’existence et leur vécu se modifient.
C’est vrai des individus. C’est encore plus vrai, l’histoire le montre, des sociétés et des classes sociales. Prenons l’exemple de la Révolution Russe, dont le dénouement est censé prouver le
caractère immuable de la nature humaine. En réalité, c’est le contraire qu’elle démontre.
Pendant des siècles, le peuple russe a souffert et a été opprimé par le despotisme des tsars. C’était le pays de la plus profonde ignorance, de la plus stupide superstition, des attitudes les
plus odieuses envers les femmes, du plus abject antisémitisme. Pour l’observateur superficiel, c’était comme s’il y avait eu quelque chose d’enraciné dans "l’âme slave" qui portait
les Russes à de telles attitudes (à la différence des Français, enfants des "droits de l’homme" et de la démocratie).
Soudain, en 1905, et encore en 1917, ce même peuple russe se rebelle contre son tsar, "petit père des peuples". Il fait grève, manifeste, se livre à l’émeute, s’insurge - et fait la
plus grande révolution de l’histoire humaine.
Cette révolution mit la société cul par-dessus tête : elle se s’empara des usines, donna la terre aux paysans, retira la Russie de la guerre impérialiste. Elle accorda aux minorités
nationales le droit à l’autodétermination, mit en place l’égalité complète des hommes et des femmes, élut un Juif (Léon Trotsky) président des conseils ouvriers de la capitale et le mit à la
tête de ses armées révolutionnaires. Pour notre même observateur, il semblait dès lors que c’était la nature du peuple russe que de brûler d’une grossière ardeur révolutionnaire, encore une
fois à l’inverse du Français "raffiné".
Puis, dans les années 1920 et 1930, cette révolution fut renversée par la bureaucratie stalinienne qui écrasa sous sa botte les ouvriers et les paysans, condamna des millions de personnes à
la famine ou à l’extermination dans les camps de travail sibériens. Pour notre connaisseur du caractère russe, c’était la confirmation de leur goût indécrottable pour la tyrannie.
En réalité, la "nature" du peuple russe - ses attitudes collectives, sa psychologie et ses schémas de comportement, qui d’ailleurs diffèrent selon les classes sociales - s’avéra
changeante dans des circonstances matérielles changeantes.
L’interminable règne des tsars, avec son corollaire psychologique de servilité, s’appuyait sur l’arriération extrême de l’économie russe. La chute du tsarisme et la montée de l’enthousiasme
révolutionnaire étaient enracinées dans le mode particulier de développement du capitalisme en Russie, avec une classe capitaliste faible confrontée à une puissante classe ouvrière capable de
rassembler les masses rurales derrière elle.
L’effondrement de la révolution et le triomphe du stalinisme, avec le retour apparent de l’apathie, de la résignation et de la docilité, étaient les produits de l’isolement, après l’échec de
la révolution à l’Ouest, et de l’anéantissement presque total de la classe ouvrière dans la terrible guerre civile de 1918-1921.
Des circonstances changeantes produisirent une "nature humaine" modifiée.
Ce que démontre l’examen approfondi de ces vingt années de l’histoire russe apparaît de façon tout aussi claire dans l’histoire de l’humanité dans son ensemble. Des schémas de comportement
considérés comme immuables et éternels par certaines sociétés dans des époques données sont rejetés comme complètement antinaturels par d’autres sociétés dans d’autres périodes.
Pour la majorité des Français du 17ème siècle, la traite des noirs était considérée comme une institution parfaitement normale. L’esclavage était le résultat de l’infériorité naturelle des
Africains. Vers le milieu du 19ème siècle, cependant, il était désormais perçu comme une intolérable violation de la personne humaine. Aux Etats-Unis, ces deux visions de la nature et des
droits des Noirs coexistaient et s’affrontaient, l’une dans le Nord, l’autre dans le Sud.
Pour les indigènes américains, la propriété privée du sol n’était pas imaginable. Pour le propriétaire terrien du 18ème siècle, c’était l’un des droits de l’homme les plus "sacrés".
Pour les Grecs anciens, l’homosexualité constituait la forme la plus élevée de l’amour. Pour les Anglais de l’époque victorienne, c’était la plus honteuse. Pour les habitants de l’Inde
traditionnelle, le mariage arrangé par la famille a été la norme pendant des siècles. Pour les occidentaux d’aujourd’hui c’est quelque chose d’inacceptable et de révoltant. Changent les
conditions sociales, et change la "nature humaine".
Ces exemples pourraient être multipliés à l’infini. Ils témoignent de l’infinie mutabilité des attitudes humaines, de la morale et du comportement. Ils mettent en évidence le rôle majeur joué
dans le façonnement de la vie humaine par la culture - ce qui est socialement acquis plutôt que génétiquement hérité. Ils montrent aussi à quel point la culture évolue en fonction des
circonstances concrètes.
Les êtres humains changent selon les circonstances. Cela ne veut pas dire que la nature humaine n’existe absolument pas, comme les révolutionnaires ont souvent été tentés de l’affirmer pour
se soustraire à l’argument antisocialiste.
En fait, nier globalement l’existence d’une nature humaine permanente pose de sérieux problèmes.
D’abord, cela peut amener à considérer les hommes comme indéfiniment manipulables, et suggérer qu’un régime totalitaire contrôlant complètement les médias et l’éducation des enfants peut
faire des gens ce qu’il veut et éliminer toute possibilité de révolte. Il est clair que ce n’est pas le cas. Pas plus dans l’Allemagne hitlérienne que dans la Russie de Staline - les régimes
totalitaires les plus intenses qui aient jamais existé - les dirigeants n’ont été capables de supprimer toute résistance et toute pensée libre. Même dans les camps de concentration, des
hommes ont organisé la résistance et se sont battus.
Il y a toujours une limite à la capacité de l’État à laver les cerveaux, et cette limite est atteinte lorsque, entre autres choses, l’oppression entre en conflit avec les besoins humains les
plus élémentaires.
Ensuite, suggérer que la nature humaine n’existe pas implique qu’il n’y aurait pas de caractéristiques communes à tous les hommes, les différenciant des autres créatures. Tout démontre le
contraire. Si c’était vrai, il ne serait tout simplement pas possible de parler d’espèce humaine, ou d’histoire de l’humanité.
Alors, que peut-on dire de la nature humaine ?
Commençons par la biologie. Les hommes sont une espèce biologique particulière, possédant un code génétique spécifique. Ce code génétique détermine la structure physique fondamentale des
êtres humains.
Bien sûr, en dernière analyse, cette nature biologique n’est ni fixe ni éternelle. Mais le rythme de l’évolution est très lent, et d’un ordre complètement différent de celui du développement
historique. Les hommes d’aujourd’hui ne sont pas biologiquement différents de leurs ancêtres d’il y a 10.000 ou 20.000 ans. Dans le cadre de la question qui nous occupe, à savoir la
faisabilité du socialisme, la nature physique des humains peut être considérée comme constante.
Cette nature physique assigne aux hommes un certain nombre de besoins communs et de capacités communes, qui sont les fondements de la nature humaine.
Les plus basiques et les moins contestables de ces besoins sont l’air, la nourriture et l’eau, puis l’habillement, le logement et la chaleur. Il y a un besoin de sommeil, d’une certaine forme
de suivi parental - les humains, à la différence des animaux, mettant de nombreuses années à devenir autonomes - d’une activité sexuelle permettant la continuité de l’espèce, etc.
Les capacités comportent les cinq sens, un cerveau volumineux, la position verticale, des mains pouvant effectuer des opérations précises, des cordes vocales permettant la parole, etc. On
pourrait objecter que les hommes ne partagent pas l’ensemble de ces capacités - certains naissent aveugles, sourds ou handicapés - mais ce sont là des exceptions.
Ces besoins et ces capacités, partagés par tous les hommes, dans toutes les sociétés et à toutes les époques, durant les 20 ou 30.000 dernières années, constituent les fondations de la nature
humaine. Cela dit, c’est la façon dont ces capacités sont utilisées pour satisfaire ces besoins qui fait des êtres humains une espèce différente de toutes les autres. Les hommes pourvoient à
leurs besoins en travaillant ensemble pour produire leurs moyens de subsistance.
Bien sûr, les animaux travaillent aussi dans un certain sens : les écureuils amassent des noix, les lions chassent, les castors construisent des digues, les oiseaux bâtissent leurs nids,
certains gorilles utilisent des bâtons comme outils, etc. Le travail humain, lui, s’est développé progressivement pour devenir quelque chose de plus évolué que cela. La production
systématique et consciente d’outils - appelés moyens de production - a énormément amélioré les capacités productives du travail.
Alors que le travail des animaux demeure essentiellement instinctif, et donc répétitif à travers les générations, le travail humain est appris et se développe - d’abord lentement et ensuite à
un rythme qui s’accélère. Le travail animal laisse l’environnement pratiquement inchangé, ou ne le modifie que très peu, le travail humain, par contre, transforme progressivement le cadre de
vie.
Le caractère social du travail est également d’une importance fondamentale. Le philosophe grec Aristote a défini l’homme comme un "animal social" : les humains ont toujours vécu en
groupes, jamais isolés. De même, leur travail a toujours été, depuis les temps les plus reculés, de nature sociale et coopérative. Lorsque les hommes de l’âge de pierre chassaient, ils le
faisaient collectivement, en bande ou en groupe nomade.
C’est très probablement ce travail coopératif qui a provoqué l’apparition d’une autre caractéristique de base des êtres humains, le langage. Toutes les sociétés humaines connues se sont
développées au point de posséder une langue d’une grande complexité. A son tour, le langage constitue un élément décisif dans l’élaboration de la conscience sociale. La culture peut alors
être apprise, et transmise d’une génération à l’autre.
À ce stade, nous pouvons résumer le traits principaux de la "nature humaine". Les hommes sont une espèce biologique distincte, porteuse d’un certain nombre de besoins fondamentaux communs qui
sont satisfaits par le travail social coopératif, qui mène au développement du langage, de la conscience sociale et de la culture.
L’élément le plus important de cette définition de la nature humaine réside en ceci qu’en même temps qu’elle établit une certain nombre de continuités essentielles, elle comporte aussi
l’aspect dynamique qui est celui du travail social.
En même temps que les humains transforment leur environnement, ils se modifient aussi eux-mêmes, ainsi que leur relation avec les autres. En exerçant leur capacité à satisfaire leurs besoins,
ils augmentent et développent leur compétence - "L’appétit vient en mangeant", disait Marx. En même temps qu’ils sont satisfaits, ces besoins s’élargissent et de nouveaux surgissent.
Le besoin de nourriture en tant que tel devient le désir d’une nourriture d’une certaine qualité. Le besoin d’habillement se développe, à partir de peaux et de fourrures, en un besoin
d’argent pour acquérir des vêtements dans des boutiques de prêt-à-porter.
Les formes de la production changent avec l’organisation de la société. En passant de la chasse et de la cueillette à l’agriculture, et de l’agriculture à l’artisanat et à l’industrie, nous
passons du clan nomade au village, et de celui-ci à la ville et à la nation moderne. Au cours de ce processus, le comportement et la nature humaine changent radicalement. Comme dit Marx dans
le Manifeste Communiste :
Les idées des hommes, leurs vues et leurs conceptions, en bref, la conscience humaine, changent avec les modifications de leur existence matérielle, dans leurs rapports sociaux et dans
leur vie sociale.
La nature humaine est loin d’être immuable. Bien au contraire, la capacité de changement et de développement en est un élément essentiel. C’est l’un des traits fondamentaux qui différencient
les hommes des animaux.
Enfin, si la nature humaine est telle que nous l’avons décrite, est-elle fondamentalement "bonne" ou "mauvaise" ? La signification de "bon", c’est ce qui est au service
de l’homme et contribue à satisfaire ses besoins et à poursuivre son développement. Ce qui est "mauvais", c’est ce qui est contraire à la nature humaine, l’empêche d’agir dans le sens de ses
besoins et de son évolution.
C’est la raison pour laquelle ce que les gens considèrent comme bon ou mauvais varie selon les périodes historiques. Les circonstances changent, les besoins changent et la morale change. Ceci
s’applique aux différentes classes sociales à des époques diverses - leurs conditions d’existence diffèrent, leurs intérêts sont opposés et par conséquent elles développent des morales
différentes.
Le capitalisme et la nature humaine
Comme tout le reste, le capitalisme en tant que système économique est perpétuellement changeant. Le capitalisme aujourd’hui est très différent de ce qu’il était à l’époque de Karl Marx et de
Napoléon III.
Quand Marx écrivait Le Manifeste Communiste, en 1848, le capitalisme n’était réellement installé que dans une partie de l’Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord. Aujourd’hui, il
domine le monde. En 1848, les principales unités de production capitalistes étaient de petites usines, appartenant à des individus ou à des familles. Aujourd’hui, le capitalisme est dominé
par des firmes multinationales géantes comme Exxon, Ford ou ICI.
Quand Friedrich Engels rédigea La condition des masses laborieuses en Angleterre, en 1844, les ouvriers de Manchester, y compris les enfants, travaillaient 12 à 14 heures par jour pour des
salaires de misère, et vivaient dans des sous-sols. Aujourd’hui, les ouvriers de Manchester ont considérablement amélioré leur sort, mais des conditions aussi terribles, et même pires,
peuvent être rencontrées à Calcutta, au Caire ou à Rio de Janeiro.
Malgré ces changements et beaucoup d’autres, certains traits fondamentaux subsistent, qui identifient le système économique comme capitaliste. Les plus importants sont les suivants :
- Les moyens de production essentiels (comme les usines, la terre, les machines et les moyens de transport) sont possédés ou contrôlés par une petite minorité de la population - les
capitalistes.
- La grande majorité de la population n’ayant aucun accès à la propriété ou au contrôle des moyens de production, elle est contrainte, pour gagner sa vie, de vendre sa force de travail à
ces capitalistes. De plus, elle est obligée de vendre cette force de travail à des conditions qui permettent aux capitalistes d’en extraire un surplus, ou profit.
- Les moyens de production sont répartis entre les différents capitalistes (qu’ils soient des individus, des groupes ou des Etats capitalistes) qui produisent en compétition les uns contre
les autres. La mesure de cette concurrence est le profit. La course continue au profit oblige ceux qui contrôlent les unités de production capitalistes à exploiter leurs salariés au maximum.
Les partisans du capitalisme ont toujours expliqué que tout ceci correspond en quelque sorte à la "nature humaine".
Il a pu y avoir un élément de vérité dans cet argument. Lorsque le capitalisme est apparu comme système (Il y a entre 500 et 200 ans), il possédait la capacité de satisfaire les besoins
humains fondamentaux, comme la nourriture, les vêtements et le logement, mieux que ne l’avait fait le vieil ordre féodal. Tout le reste n’est qu’absurdité.
D’abord, il est absurde de proclamer que le comportement façonné par le capitalisme est "naturel" ou instinctif, alors que le développement humain a mis deux millions d’années pour parvenir
au capitalisme. Pas plus le commerce de marchandises en général que l’achat et la vente de travail (les traits centraux du capitalisme) n’apparaissent où que ce soit dans le monde naturel ou
dans les premiers temps de l’histoire humaine.
Bien au contraire, l’histoire montre que les gens n’ont pu être amenés à vendre leur force de travail à un employeur que lorsqu’ils ont été privés de toute possibilité de gagner leur vie en
travaillant pour eux-mêmes. Ce fut particulièrement le cas en Angleterre par la fermeture des terrains communaux entre le 15ème et le 19ème siècle.
La constitution d’une classe assez riche pour investir dans l’industrie et acheter la force de travail sur une grande échelle nécessitait un processus extrêmement brutal, que Marx a appelé
"l’accumulation primitive du capital". Celle-ci impliquait la mise en esclavage de millions d’Africains et leur transport en Amérique, le génocide de la plus grande partie des populations
indigènes d’Amérique centrale et méridionale, le pillage et l’appauvrissement de l’Inde et de l’Extrême-Orient, et d’autres barbaries innombrables.
De plus, pour parvenir à établir leur domination, le capitalisme et la classe capitaliste ont dû mener toute une série de luttes révolutionnaires violentes et de guerres civiles contre la
vieille aristocratie féodale, allant jusqu’à couper la tête du roi en Angleterre et en France. On peut voir qu’il n’y a rien eu de particulièrement "naturel" dans l’avènement et le
développement du capitalisme.
Il est également faux de dire que le capitalisme fait de l’intérêt individuel égoïste la force motrice de la production. Le moteur du capitalisme, c’est le profit, mais les profits ne sont
accessibles qu’à l’infime minorité de la population qui possède le capital. Pour la grande majorité des individus, le capitalisme est basé au contraire sur le déni de l’intérêt personnel.
C’est la raison pour laquelle les patrons supplient en permanence leurs ouvriers de cesser de trop demander. C’est aussi pour cela que les employeurs ont toujours essayé de faire voter des
lois restreignant les droits des travailleurs à poursuivre la satisfaction de leurs intérêts au moyen de leurs syndicats. La Révolution Française n’est pas seulement la mère des "Droits de
l’Homme et du Citoyen". Elle est aussi celle de la Loi Le Chapelier (1791) interdisant toute coalition ouvrière.
Loin d’être l’expression de la nature humaine, le capitalisme s’empare de l’élément le plus important de la nature humaine - la capacité de travail - et le défigure complètement.
En traitant le travail comme une marchandise qui se vend et s’achète, le capitalisme le rend étranger au travailleur. Au lieu d’être le moyen par lequel les êtres humains transforment
consciemment la nature pour satisfaire des besoins individuels et collectifs, le travail devient la seule façon d’obtenir l’argent nécessaire à la survie sociale.
Les travailleurs perdent tout contrôle de leur énergie créatrice, qui se trouve réduite à une tâche répétitive, souvent idiote, physiquement et psychologi-quement destructive. Le résultat,
c’est qu’ils passent 40 ou 50 ans de leur vie à faire un métier qu’ils détestent, ou qu’ils supportent à peine, qui épuise leur corps et brise leur âme.
Le capitalisme va jusqu’à priver des millions d’individus de la simple possibilité de travailler, les jetant au chômage dès que leur travail ne produit plus un profit suffisant. Ainsi, ce qui
est essentiel à tout être humain, qui est accessible aux "sauvages" qui chassent et cueillent - la possibilité de s’engager dans un labeur socialement utile – se trouve interdit à de larges
masses d’êtres humains.
L’aliénation du travail n’affecte pas seulement l’atelier ou le bureau. Elle produit son effet sur l’ensemble des relations sociales. Les rapports entre travailleurs, entre parents et
enfants, entre hommes et femmes, les relations amoureuses et sexuelles, en sont faussés, défigurés.
Les gens se traitent mutuellement comme des objets ou des marchandises indéfiniment utilisables et manipulables. Le sexe lui-même devient un produit de consommation, et on l’utilise pour
vendre d’autres denrées. Souvent les individus les plus aliénés et les plus maltraités cherchent à compenser leur impuissance et leur oppression, au travail ou dans la société en général, en
infligeant toutes sortes de tourments à d’autres, plus vulnérables qu’eux-mêmes.
Rien de tout cela n’est naturel, ou l’œuvre de la nature humaine. C’est le produit d’un système qui viole la nature humaine.
En définitive, le capitalisme est singulièrement inapte à satisfaire les besoins les plus fondamentaux des êtres humains - le besoin d’eau, de nourriture, de vêtements et de logement. La
production alimentaire dépasse la croissance démographique, des "lacs de vin" et des "montagnes de viande" sont accumulés, pendant que des dizaines de millions d’êtres ont faim. Des millions
et des millions d’hommes souffrent et meurent de maladies faciles à soigner et à prévenir. Dans des pays riches comme la France ou les USA les ressources existent pour construire des hôtels
de luxe et des bureaux. Pourtant des gens dorment dans la rue parce qu’ils n’ont pas d’abri pour la nuit.
Ce n’est ni naturel ni imposé par la nature. Les soi-disant "primitifs" du Kalahari sont capables d’extraire d’un quasi-désert, par la chasse et la cueillette, un meilleur régime alimentaire
que des millions d’hommes qui meurent de famines provoquées par d’autres hommes, ou qui subsistent tant bien que mal dans les bas-fonds des grandes métropoles. Les esquimaux sont capables de
construire, à partir de blocs de glace, un abri plus chaud que les emballages de carton dont s’enveloppent ceux qui dorment dans les rues de Paris.
Ces horreurs se produisent parce que le capitalisme réserve l’accès aux nécessités de la vie à ceux qui ont un "pouvoir d’achat" suffisant, en même temps qu’il empêche les plus larges masses
humaines d’obtenir ce pouvoir d’achat.
Dans sa quête effrénée du profit, le capitalisme en arrive à empoisonner l’air et l’eau, menaçant de destruction l’environnement naturel qui a produit et entretenu la vie humaine.
Le socialisme et la nature humaine
Si, du point de vue de la nature humaine, le capitalisme semble condamné, qu’en est-il du socialisme ?
Si nous acceptons l’existence, au minimum, d’une nature humaine de base, n’est-il pas possible qu’il y ait, profondément enracinées en elle, des caractéristiques qui empêchent la réalisation
d’une société sans classes, d’une société autogérée, dans laquelle tous seraient égaux et libres ? N’y a-t-il pas, peut-être, une volonté de puissance ou un besoin de domination
irréductible, qui fait que la société sera toujours divisée entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés ? Se pourrait-il que l’existence d’inégalités physiques naturelles entre les
individus forme un obstacle incontournable à l’égalité sociale ?
Nous pouvons donner une réponse concrète et simple à ces questions. Pendant des dizaines, probablement des centaines de milliers d’années, les êtres humains ont vécu dans des sociétés sans
propriété privée, sans divisions de classe, sans dirigeants et sans Etat.
Les recherches archéologiques montrent que les premiers outils – de silex – datent d’environ 2,5 millions d’années. De cette époque jusqu’à il y a 10.000 ans, les humains ont vécu comme des
prédateurs opportunistes, puis comme des chasseurs-cueilleurs, organisés essentiellement en petits groupes nomades.
Pendant toute cette période, il n’y eut ni agriculture, ni poterie, ni moyens de transport. Il n’était possible ni pour la communauté, ni pour aucun des individus la composant, d’accumuler un
surplus de biens au-delà de ce qui était nécessaire à la survie quotidienne.
En l’absence d’un tel surplus, il ne pouvait y avoir de division de la société en classes, avec une couche de gens au sommet vivant du travail de ceux d’en bas. Il ne pouvait pas davantage y
avoir de dirigeants permanents disposant de corps spéciaux d’hommes armés pour assurer leur pouvoir. Tout le monde était occupé à la production des nécessités de la vie. Ainsi, pendant 99% du
temps depuis lequel ils existent comme espèce, les humains ont vécu dans des communautés sans classes.
L’existence de sociétés sans classes n’est pas seulement attestée par la recherche archéologique ou la déduction logique. Des groupes se livrant à la chasse et à la cueillette ont survécu
jusqu’à l’époque moderne avec un mode de vie similaire, qui peut être observé par l’anthropologie scientifique.
Un bon exemple est constitué par les !Kung San du Kalahari, en Afrique méridionale, qui ont été étudiés par un certain nombre d’anthropologues, parmi lesquels l’américain Richard Lee.
Les !Kung habitent le désert du Kalahari depuis au moins 10.000 ans. Ils vivent en petits groupes d’une trentaine de personnes, déplaçant leur campement tous les quinze jours. Ils
accumulent très peu de biens matériels, rien de plus que ce qu’ils peuvent transporter lorsqu’ils se déplacent, mais ils possèdent une très riche culture orale. Une connaissance détaillée de
leur environnement leur permet d’accéder à un mode vie au jour le jour satisfaisant. La nourriture, chassée ou cueillie, est partagée collectivement par la communauté. Richard Lee
écrit :
La pratique du partage imprègne profondément le comportement et les valeurs des !Kung, à l’intérieur de la famille aussi bien que dans les rapports entre familles ; de la même
façon que le principe de profit et de rationalité est central dans l’éthique capitaliste, le partage est fondamental dans la conduite de la vie sociale des sociétés de chasse et de
cueillette.
Les !Kung sont profondément égalitaires. Non seulement ils ne sont pas divisés en riches et pauvres, mais ils n’ont ni chefs ni dirigeants. Richard Lee leur demanda un jour s’ils avaient
des chefs. « Bien sûr que nous avons des chefs », fut la réponse. « En fait nous sommes tous des chefs, chacun d’entre nous est son propre chef ».
Résumant les leçons de son travail de terrain parmi les !Kung et de sa connaissance d’autres sociétés de chasseurs-cueilleurs, Richard Lee écrit :
Le fait que le partage communautaire des ressources alimentaires ait été directement observé au cours des dernières années parmi les !Kung et des douzaines d’autres groupes
similaires est une découverte dont il n’est pas possible d’exagérer l’importance. Son caractère universel dans les sociétés de chasse-cueillette apporte un soutien puissant à la théorie
développée par Marx et Engels selon laquelle un stade de communisme primitif a été dominant avant l’apparition de l’État et l’éclatement de la société en classes…
La réalité d’une vie véritablement communautaire est souvent niée comme utopique, possible en théorie mais irréalisable dans la pratique. Mais la preuve du contraire nous est apportée par
les sociétés vivant de chasse et de cueillette. Un mode de vie de partage n’est pas seulement possible, il a réellement existé dans de nombreuses parties du monde et pendant de longues
périodes.
Cette preuve n’est pas apportée dans le but de suggérer que ce que nous trouvons dans de telles sociétés correspond à « l’état de nature », ou que la nature humaine est
« par essence » socialiste. Cela consisterait tout simplement à reprendre à l’envers l’argument antisocialiste, en répétant la même erreur de méthode.
Le socialisme moderne promet beaucoup plus que la simple compatibilité avec la nature humaine. Le socialisme ne signifie pas aujourd’hui un retour au communisme primitif, mais un gigantesque
progrès basé sur les réalisations technologiques de millénaires de société de classe.
Le communisme primitif était basé sur l’absence de tout surplus accumulé. Le socialisme moderne se fonde sur le fait que les forces productives se sont développées au point qu’il existe un
surplus suffisant pour assurer une vie décente à tous sans que la vie des gens ordinaires soit consumée par un incessant labeur.
Le socialisme signifie aujourd’hui se saisir de l’immense richesse, de la capacité productive, de la science et de la technologie, pour l’instant monopolisées par les sociétés
multinationales, les milliardaires et leurs Etats, et les soumettre au contrôle démocratique collectif à l’échelle internationale.
Il apporterait à suffisance nourriture, vêtements et logement à chacun sur la planète, et la disparition de la famine et de la pauvreté. Dans le même mouvement, il unirait la race humaine,
mettant fin à l’exploitation, aux antagonismes nationaux, à la guerre, au racisme et à l’oppression sexuelle en supprimant les circonstances matérielles qui les provoquent.
Il mettrait les gens en situation de contrôler collectivement leur propre travail et le produit de ce travail. Il surmonterait ainsi l’aliénation fondamentale et la distorsion de la nature
humaine qui s’est perpétuée pendant les millénaires d’esclavage et de servage, atteignant un sommet avec le travail salarié capitaliste.
Il transformerait et libérerait les rapports personnels et sociaux, produirait un environnement calculé pour répondre aux besoins et faciliter le développement humain, permettrait de
planifier rationnellement l’effet de l’activité humaine sur la nature, mettant fin à la destruction de l’environnement.
Un trait fondamental de la nature humaine est la créativité artistique. Le plus ancien objet gravé date de 300.000 ans. Toutes les sociétés humaines ont leur musique et leurs danses.
Sous le capitalisme, comme dans toutes les sociétés de classe, l’activité artistique est essentiellement le domaine des privilégiés – la créativité de la majorité des gens est étouffée. Le
socialisme libérera cette créativité en élargissant les loisirs et l’éducation pour tous, et rétablira l’élément artistique de la production. Il produira une immense floraison culturelle.
Ainsi, le socialisme ne se bornera pas à satisfaire les besoins matériels communs à tous les êtres humains, il apportera aussi un développement à tous les niveaux, un enrichissement et une
croissance de la nature humaine. Ce n’est pas seulement possible. C’est nécessaire, et ça vaut le coup de se battre pour cela.
 CARREFOUR ANTICAPITALISTE
Gauche radicale écologiste
CARREFOUR ANTICAPITALISTE
Gauche radicale écologiste
























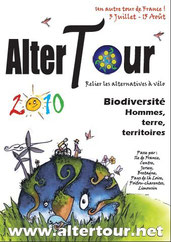


































































































































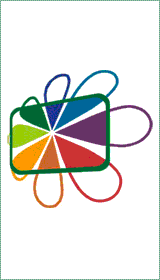

























































































Écrire commentaire